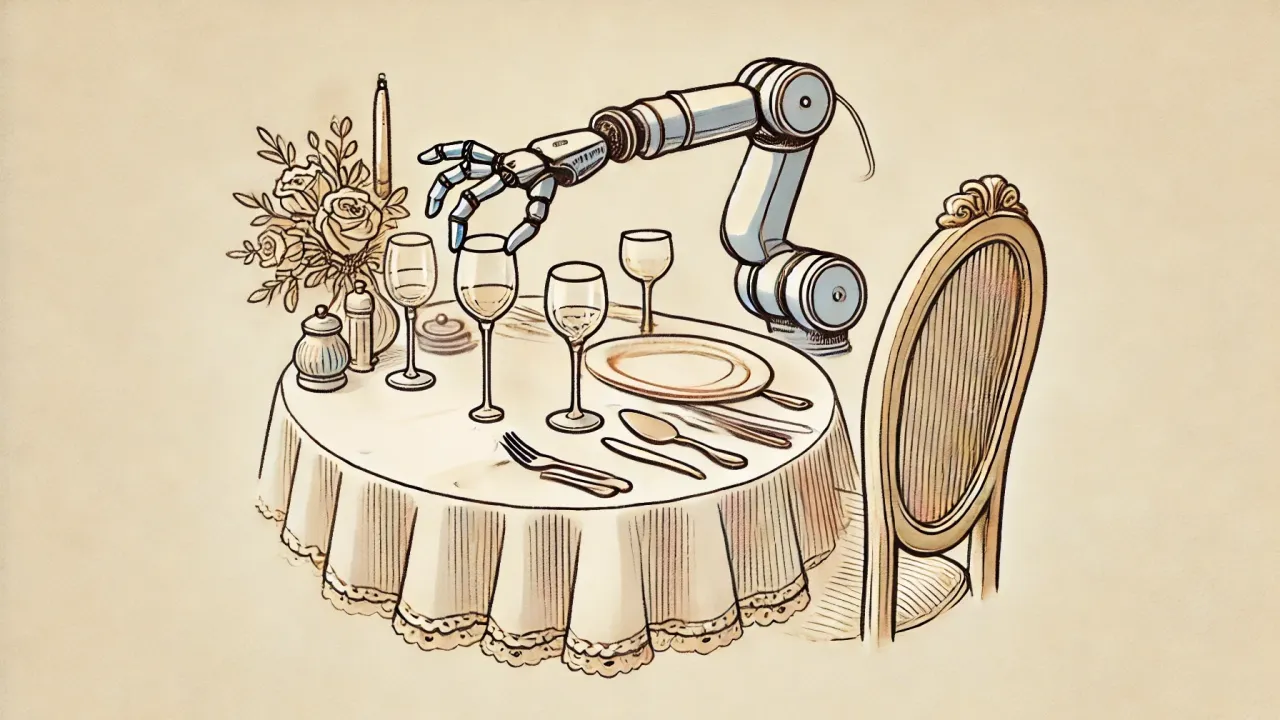Je retombe sur un vieux numéro de la revue Autrement, sorti en janvier 1986. À l’époque, la publication est encore jeune et se donne pour objectif d’explorer des faits de société sous divers angles et points de vue. En janvier 1986, donc, la revue s’attelle, sous la direction de la journaliste et historienne Pascale Froment et de l’écrivain et traducteur Brice Matthieussent, au thème du faux. Autant dire que, quarante ans plus tard, en plein monde post-vérité et post-ChatGPT, la lecture en est troublante.
Dans les quelque 222 pages de ce numéro, on retrouve nombre d’experts, artistes, penseurs et provocateurs en tous genres, à commencer par le théoricien du « tout-faux » en personne, Jean Baudrillard, qui livre son lot d’analyses et de saillies savoureuses.
On connaît la thèse de Baudrillard sur la prééminence des images sur le monde. Dans Simulacres et simulations (1981), le philosophe explique que la technologie et les médias multiplient les simulacres — c’est-à-dire des représentations du monde — jusqu’à ce que ces dernières prennent la place du réel. On passerait insidieusement d’images fidèles à la réalité, à des images qui la déforment, puis qui finissent par s’en découpler complètement. La carte ne reflète plus le territoire ; elle le précède voire le dicte.
En ce mois de janvier 1986, Baudrillard creuse son sillon dans les pages d’Autrement : avec les avancées technologiques, les médias renverraient des images de plus en plus figuratives, c’est-à-dire prétendant au réalisme, là où elles seraient au contraire de plus en plus manipulées et vides de sens. Une sorte d’effet de ciseaux qu’il va carrément qualifier de « diabolique » !
Autre citation dont la lecture est saisissante 40 ans après : « Le miroir et son apparition ont introduit dans le monde des perceptions un effet ironique de trompe-l’œil, et l’on sait quel maléfice s’attache à l’apparition d’un double. » Intéressant à relire dans un monde où nous sommes désormais habitués à nous voir à la troisième personne, à travers nos selfies ou notre retour caméra dans Teams…
Pour conclure, Baudrillard est un grand pessimiste quant à nos capacités à dépasser l’empire du faux : « (Face aux images) nous demeurons d’une naïveté incroyable (…) je ne crois pas à la pédagogie de l’image. » Ambiance.
Plus léger : un peu plus loin dans la revue, on tombe sur un court papier de Pascale Froment, qui décrit son métier alors balbutiant car importé des États-Unis : fact-checker. Un journalisme entièrement dédié à combattre le Faux ! Pour Froment, l’existence de cette fonction dans les rédactions n’est pourtant pas due à l’amour inconditionnel de la vérité, mais plutôt à une logique de prévention contre les actions en justice dont les américains sont dits friands…
Pascale Froment se présente comme un Don Quichotte du Faux, une passionaria du fact-checking : elle est capable d’aller très loin pour valider la moindre information, comme la quantité de cire exacte servant à fabriquer des cierges. Elle dit même être allée jusqu’à joindre Jorge Luis Borges au Japon pour confirmer une simple citation… Une anecdote savoureuse quand on pense à quel point Borges a construit son oeuvre à la frontière entre invention et réalité.
Comme l’analyse de Baudrillard, la lecture de l’article de Froment est fascinante a posteriori. Si le fact-checking est désormais devenu mainstream, sa légitimité s’est affaiblie. La pratique en soi n’a jamais été aussi simple grâce au numérique, mais elle peut aussi paraître dérisoire, tant la notion de Vérité semble devenue relative…
Ce numéro d’Autrement éclaire une période d’intenses transformations économiques et technologiques, qui suscitent curiosité et inquiétude. Sous la plume de Froment, Matthieussent et leurs comparses émerge une vision finalement assez désabusée, très fin de siècle du monde — on est en 1986, après tout, et l’incident de Tchernobyl n’a même pas encore eu lieu.
De fin de siècle, d’angoisse de la modernité et de fausseté généralisée, il en est aussi beaucoup question dans l’ébouriffante biographie qu’Agnès Michaux vient de consacrer à Joris Karl Huysmans, l’archétype de l’artiste désenchanté, vitupérant sans cesse contre son temps.
Huysmans et ses proches ne goûtent guère au triomphe de l’industrie, au tourisme, à la démocratie. Pour eux, l’époque est au « panmuflisme » (tout le monde est mufle, grossier, vil), malhonnête, « américaine »… Cette modernité exécrée, Huysmans va pourtant en faire le matériau-même de son oeuvre, d’abord avec une approche naturaliste, où il n’épargne à son lecteur aucun détail sordide de la vie des petites gens, avant de prendre un chemin plus complexe et riche.
SUBLIMER LE FAUX
Dans son chef-d’œuvre À rebours (1884), qui narre la fuite intérieure d’un aristocrate fin de race face à une société industrielle qui le dégoûte, Huysmans va lui aussi traiter du Faux de l’époque, pour le dénoncer… mais aussi le sublimer.
L’unique personnage du roman, Jean des Esseintes, aime se retirer dans sa « thébaïde » (un lieu isolé) de Fontenay-aux-Roses. Fontenay, cette vraie-fausse campagne aux portes de Paris où Huysmans avait lui aussi une propriété dans laquelle il avait fait planter ses fleurs qu’il décrivait comme « presque artificielles ». Ces mêmes fleurs reviendront chez son héros, qui se délectera de l’ambiguïté entre réel et factice :
« Après les fleurs factices singeant les véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs fausses. »
C’est là un motif central d’A rebours: quand le réel déçoit, l’artifice se fait refuge.
Le duc des Esseintes éprouve un tel dégoût du monde qu’il préfère en recréer un (voire plusieurs) de toutes pièces, en multipliant les décors et rituels. L’homme malmène la nature, en incrustant de pierreries la carapace d’une tortue vivante ou en gardant un grillon dans une « cage de fils d’argent » pour parfaire l’atmosphère d’un boudoir… Il fait préparer des plats à l’aide d’un « sustenteur », dénaturant complètement les ingrédients qui les composent. Il vit entouré de livres rares sans cesse ré-arrangés de manière sophistiquée.
Le caractère faux et affecté d’une époque superficielle est dénoncé, mais il est aussi embrassé, voire transcendé.
Le plus fascinant dans ce personnage, c’est aussi sa postérité. Certains pensent que le vrai dandy Robert de Montesquiou a en partie inspiré le dandy de fiction Des Esseintes. Pour Agnès Michaux, c’est Des Esseintes qui va en réalité cristalliser le caractère de Montesquiou, sa réputation sulfureuse, son « positionnement marketing » dans la société de la Belle Epoque… Jusqu’à ce qu’ils serve de support à un autre anti-héros culte: le Baron Charlus de La Recherche du temps perdu… Vertigineux allers-retours entre la réalité et le roman, entre le Vrai et Faux !
Quarante ans après la publication de la revue Autrement, et cent quarante ans après celle d’A rebours, le fake — IA, infox, dupes... — est devenu la norme. Le Faux pourrait-il sauver le Vrai ? La fuite en avant ne se termine pas forcément bien pour Jean des Esseintes mais dans un monde désenchanté, la Fiction peut certainement sauver le Réel. Une touche d’artifice, de mensonge pour mieux dire la vérité et s'ancrer dans le concret. Comme l’écrivait Proust, « La vraie vie (…) c’est la littérature ».