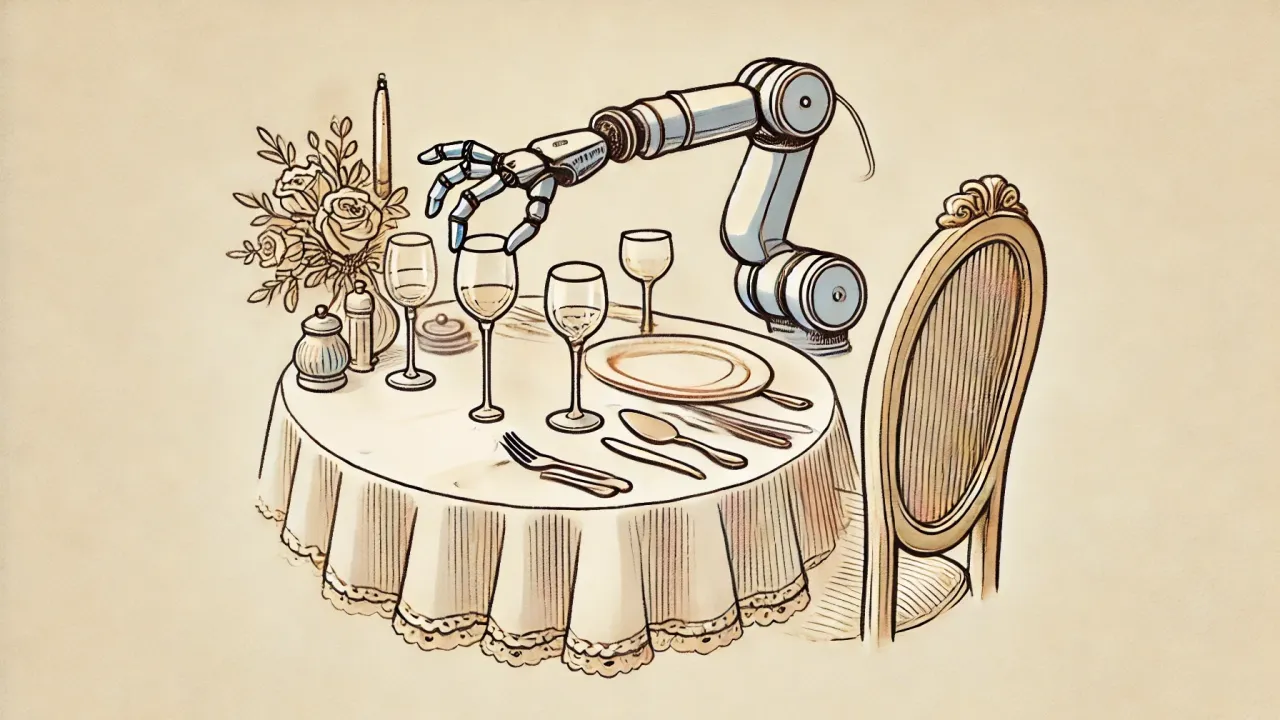L’une de mes hypothèses récurrentes est que l’explosion de l’usage de l’I.A. générative va mécaniquement pousser les industries créatives à déplacer l’emphase du produit créatif au processus créatif lui-même. Plus que jamais, c’est le concept qui comptera plus que l’ouvrage, la réflexion plus que le résultat final. Ce qui vend, c’est l’être — ou le collectif — humain, avec sa patte et sa voix propre. En faisant la démonstration, idée par idée, geste par geste, du chemin qui conduit à l’œuvre, on montre ce qui la rend unique, respectable, désirable.
Du point de vue des médias ou des industries créatives, cela signifiera demain encore davantage de making-ofs ; la publication de livres d’exégèse, de moodboards, de carnets ; l’ouverture systématique aux caméras des studios, des coulisses, des ouvroirs… Une logique qui suit aussi celle des médias sociaux, qui rendent désormais le « para-contenu » presque plus important que l’œuvre elle-même. Le succès d’un morceau, d’une série ou d’un produit tient de plus en plus au « lore », aux memes ou au « reaction videos » qui les entourent. Les créateurs, studios ou marques auront tout intérêt à jouer là-dessus pour ancrer leur vision artistique — et justifier leur prix.
Mais jusqu’où aller dans la transparence ? Où se situe la limite entre dévoiler et révéler, montrer et déflorer ?
Dans À la recherche du temps perdu, Françoise, la domestique du narrateur, est un personnage secondaire mais essentiel. En partie inspirée de la gouvernante de Proust, Céleste Albaret, elle est une présence sans âge (l’auteur prend beaucoup de liberté avec le passage du temps) qui accompagne le jeune écrivain tout au long de sa vie, vers sa maturité artistique. Le narrateur se moque d’elle fréquemment, bien qu’avec une certaine tendresse. Simple d’esprit, mesquine et émotive, Françoise se distingue néanmoins par sa fidélité et ses talents de chef. En cuisine, elle est même comparée à Michel-Ange ! Son chef-d’œuvre culinaire, le bœuf en gelée, est mentionné deux fois dans La Recherche, dès À l’ombre des jeunes filles en fleurs, puis dans Le Temps retrouvé. Un tel placement en miroir, presque en « serre-livres », montre son importance symbolique, comme métaphore de l’Oeuvre d’Art élaborée avec patience et mystère.
Pourquoi parler ici de ce plat de cuisine bourgeoise par excellence ? Dans le 2e tome de la Recherche, Françoise réalise un bœuf en gelée extraordinaire, qui ravit les invités les plus snobs de la maison, tel le diplomate M. de Norpois. Néanmoins, lorsqu’elle est interrogée sur le secret de sa recette, Françoise affirme ne pas savoir comment elle parvient à l’excellence.
« Mais enfin, lui demanda ma mère, comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous (quand vous le voulez) ? » « Je ne sais pas d’où ce que ça devient », répondit Françoise (qui n’établissait pas une démarcation bien nette entre le verbe venir, au moins pris dans certaines acceptions et le verbe devenir). Elle disait vrai du reste, en partie, et n’était pas beaucoup plus capable — ou désireuse — de dévoiler le mystère qui faisait la supériorité de ses gelées ou de ses crèmes, qu’une grande élégante pour ses toilettes, ou une grande cantatrice pour son chant. Leurs explications ne nous disent pas grand chose ; il en était de même des recettes de notre cuisinière.
On peut voir dans la réponse de Françoise une ingénuité sincère, la marque du génie de la main des petites gens. On peut aussi y déceler une véritable stratégie de rétention d’information. Car si Françoise livre trop ses secrets, elle devient remplaçable par une autre cuisinière. En jouant la carte de l’ignorance, elle demeure incontournable.
Comment raconter sans dévoiler, transmettre sans banaliser ?
Les modèles d’I.A. fonctionnent comme d’immenses boîtes noires : on ignore quelles données y entrent, comment elles sont digérées, et pourquoi elles répondent comme elles le font. Appliquée aux enjeux liés à l’IA, l’approche de Françoise reviendrait à opposer aux boîtes noires des machines une autre boîte noire, celle d’un savoir-faire hermétique.
Cela concerne bien entendu toutes les formes de création intangibles, mais aussi, demain, les gestes eux-mêmes.
Il y a quelques semaines, j’écoutais Alexandre Boquel, Directeur des Métiers d’Excellence de LVMH, expliquer au Paris Luxury Summit qu’il travaillait à la captation numérique complète de gestes artisanaux afin de préserver les savoir-faire rares et d’assurer leur transmission sur le long terme. Boquel le dit lui-même : il « ne s’interdit rien » comme support d’enregistrement : photos, vidéos, motion capture, I.A… Une initiative qui rappelle celle du Répertoire Numérique du Geste Artisanal, une base de données en ligne sur laquelle on retrouve des dizaines de définitions et vidéos aussi brutes qu’hypnotiques d’artisans au travail.
Dans l’absolu, la démarche d’Alexandre Boquel est juste et respectable — mais que se passerait-il si tous ces gestes étaient demain non plus seulement captés mais décortiqués, dépecés en milliers de données assimilables par une I.A. associée à de la robotique de pointe ? En documentant précisément ces techniques, on peut aussi faciliter leur reproduction par des machines. Le paradoxe est alors clair : en voulant préserver l’authenticité, on risque de favoriser sa disparition.
Ce dilemme, tous les artistes et artisans y seront confrontés demain. Face à l’I.A. généralisée, il faudra de plus en plus faire la démonstration de leur savoir comme de leur savoir-faire ; mais en dévoilant trop, ils s’exposeront à tout perdre. La « tentation du boeuf en gelée » se fera alors grandissante, car ce qui est inexplicable demeure inimitable.