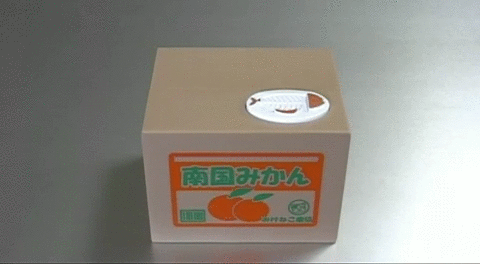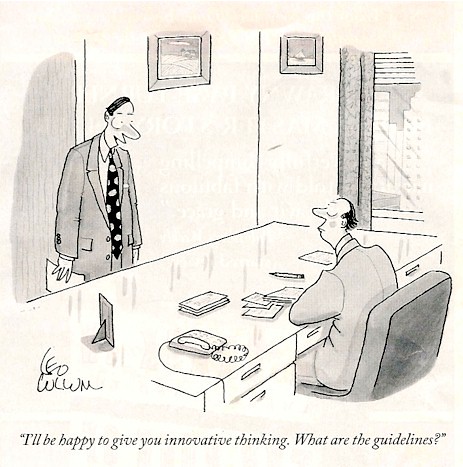Pour les travailleurs français, la rentrée 2020 aura sans doute eu un drôle de goût, mêlant des sentiments contrastés voire contradictoires vis-à-vis de leur situation professionnelle. A l’heure où l’INSEE prévoit un taux de chômage de 9,5% en fin d’année, certains craindront pour leur emploi tandis que d’autres en profiteront pour tout changer. Comment les organisations et institutions peuvent-elles aborder la complexité des réactions individuelles ?
Il y a plusieurs années, j’ai été très marqué par l’étude d’Exit, Voice and Loyalty (Défection et prise de parole) de l’économiste Albert O.Hirschman. Dans cet ouvrage paru en 1970, l’auteur offrait une grille de lecture simple et plutôt heuristique pour analyser les options qui s’offrent aux individus lorsqu’ils sont insatisfaits quant à certains aspects de leur vie.
Par exemple : vous trouvez que votre banquier vous rend un service insuffisant ? Vous avez toujours le choix entre la loyauté/loyalty (privilégier le statu quo car changer d’établissement n’est pas aisé), la voix/voice (faire part de votre mécontentement au conseiller ou à son management, afin que le service s’améliore) ou carrément la défection/exit, c’est-à-dire fermer votre compte et aller ailleurs.
Cette vision s’applique théoriquement à toutes les situations, avec plus ou moins de flexibilité entre les options — il est en effet plus simple d’arrêter d’acheter un produit décevant que de quitter sa propre famille à cause d’un conflit perçu comme insoluble. La matrice d’Exit, Voice and Loyalty s’est surtout révélée puissante dans les organisations, afin de jauger l’action des collaborateurs face aux défis petits et grands.
Cependant, elle tendait à amalgamer les comportements de loyauté, qui peuvent être plus subtils qu’il n’y paraît. Aussi, quelques années après la parution d’Exit, Voice and Loyalty, le professeur de management Dan Farrell a proposé d’ajouter une 4e option à la grille de Hirschman : neglect, c’est-à-dire le côté sombre de la loyauté, une sorte d’apathie face aux problèmes, qui pousse les collaborateurs à la négligence.
Les options se plaçaient désormais sur un mapping à deux axes, passif/actif et destructif/constructif.
Cette grille demeure très utile pour qui souhaite connaître sa position dans une organisation ou évaluer des risques chez ses collaborateurs. Néanmoins, elle n’intègre que des sources de mécontentement internes et sur lesquelles on peut semble-t-il agir directement et individuellement. Face à un hyper-phénomène comme le Covid-19, à la fois extérieur et qui nous dépasse, nous pourrions encore la préciser.
A mon sens, on pourrait de nouveau distinguer un premier axe actif/passif pour déterminer l’attitude de chaque individu vis-à-vis de la situation dans son organisation : face à l’impact de la crise, le travailleur versera-t-il dans l’attentisme où sera-t-il poussé à prendre des décisions voire davantage de risques ?
A cet axe se superposerait un second axe, non pas destructif/constructif mais pessimiste/optimiste, pour qualifier l’état d’esprit de l’individu face à la crise, au-delà de son entreprise. Le Covid-19 lui fait-il prendre conscience d’une situation privilégiée ? Peut-il avoir un impact favorable sur le long terme ?
Les deux axes forment de nouveau quatre cadrans :
- Passif x optimiste = Stoïque. Une approche « philosophe » des événements, qui consiste à se réjouir de ce que l’on a (un environnement de travail correct, des sujets intéressants, des collègues sympas…) et cultiver son jardin, par exemple en accordant davantage d’importance à la sphère familiale, en attendant des jours meilleurs.
- Passif x pessimiste = A-quoi-boniste. Une forme de résignation désabusée, où l’incertitude mène à la démotivation. On se contente de faire le dos rond sans vraiment croire à une amélioration à l’intérieur comme à l’extérieur de l’organisation. Ces personnes estiment qu’il faut « tirer le maximum » de leur boîte avant que la crise ne les affecte par une dégradation de conditions de travail voire une perte d’emploi.
- Actif x optimiste = Opportuniste. Ces personnes restent fidèles à leur organisme et redoublent de motivation car elles estiment (consciemment ou inconsciemment) que l’instabilité est une source d’opportunité pour travailler sur de nouveaux sujets, rencontrer de nouvelles personnes, réaffirmer ses valeurs… et accélérer sa carrière.
- Actif x pessimiste = Rupturiste. Pour ces personnes, la crise actuelle agit comme révélateur de leur insatisfaction vis-à-vis de leur organisation et de la société. Elles se considèrent en “fin de cycle” et reprennent la main sur leur destin en démissionnant. Elles peuvent aller à la concurrence ou se lancer dans des projets complètements différents ; l’important ici, c’est le hiatus qui permet de compenser le pessimisme.
On retrouve ici en filigrane les quatre grandes catégories de Hirschman et Farrell. En revanche, le modèle est ouvert à ce qui se passe à l’extérieur de l’organisation et affecte les dispositions psychologiques des individus. On voit dès lors combien une forme d’optimiste raisonné peut aider à la résilience des individus comme des entreprises qu’ils composent.
Et vous, où vous situez-vous ?